
Le coup du lapin.

Comme pour
Sils Maria, on avait longtemps hésité avant d’aller se confronter aux trois heures et demie de la palme d’or :
Winter sleep du turc
Nuri Bilge Ceylan (pour pas faire province, faut prononcer
Djèïlân).
Les critiques vantaient les paysages à couper le souffle et on craignait évidemment trois heures de contemplation indolente des steppes anatoliennes.
Mais non, d’autres critiques vantaient une mise en scène théâtrale et des dialogues d’une profondeur rarement égalée.
Nous voici donc armés d’un apriori enthousiaste (si, si), bien assis dans une salle confortable, toutes les cartes en main.
Au fin fond de la steppe turque, Aydin est un ancien comédien à demi raté qui écrit de petits éditoriaux pour une feuille de chou locale. Arrogant et prétentieux, il vit de ses rentes et supervise vaguement un hôtel pour trois touristes japonais. Sa sœur profite de son hospitalité pour se remettre d’un divorce. Son épouse, très belle jeune femme beaucoup plus jeune, s’ennuie à mourir et s’occupe comme elle peut à faire la charité. Des oisifs nonchalants assistés de domestiques obséquieux.
Mais avec de très très gros soucis existentiels : doit-on s’excuser d’être riche ? l’arrogance est-elle un vilain défaut ? faut-il exiger que les pauvres paient leur loyer ? l’argent fait-il le bonheur des autres ? la charité permet-elle de se donner bonne conscience ? etc …
Des caricatures d’oisifs comme on n’en fait plus, animés de débats oiseux.
En guise de paysages à couper le souffle on aura droit à une cheminée de fée (pas deux, une) et à un très beau décor : celui bobo-chic d’un hôtel troglodyte de Cappadoce. Reconnaissons qu’il faut saluer le travail de repérage et celui du décorateur. Il y a là effectivement de quoi couper le souffle de ceux qui ne voyagent jamais et vont rarement au cinéma, le jury cannois est bien connu pour ça.
Côté cinéma, c’est effectivement très bien filmé : pas un plan de travers, de belles images, un travail académique, de quoi alimenter les exégèses et les écoles pendant des années.
Il y a même de très beaux jeux de miroirs avec champ/contrechamp … mais que Ceylan (pour pas faire province, faut prononcer
Djèïlân) répète plusieurs fois avec insistance pour ceux qui se seraient endormis en route et auraient loupé les précédents, très aimable à lui.
Malgré ces atouts indéniables qui justifient presque à eux seuls la palme d’or (un blog titrait :
la palme dort …), malgré tous ces atouts donc, BMR et MAM sont sortis des trois heures et demie, ravis de pouvoir se dégourdir les jambes mais en se regardant dubitatifs : mais que donc voulait dire Ceylan (pour pas faire province, faut prononcer
Djèïlân) ?
Au bout de trois heures, quand on voit partir trois personnages imbibés d’alcool et armés de fusils pour une partie de chasse (dans des paysages à couper le souffle, rappelons-le), on se dit que ah, ça y’est, ça valait le coup de patienter et de lutter contre le sommeil, enfin, le drame va se nouer …
mais non, ce ne sera qu’un pauvre lapin qui fera les frais de l’arrogance de Aydin et de la prétention de son metteur en scène.
Trois heures et demie d’accord, pourquoi pas, mais pour finalement dire QUOI ?
Tout cela aurait pu être réduit, assaisonné et cuisiné en moins de deux heures et le turkish delice aurait pu être savouré mais là, dilué à l’envi, c’est insipide et insignifiant.
Mais on veut bien comprendre qu’à moins de trois heures, point de palme …
Peut-être que les jurés cannois auront finalement voulu récompenser l’harmonieuse osmose, finalement très réussie et très convaincante, entre le propos du cinéaste et l’immensité désertique de la steppe anatolienne.
Le comble c’est que Ceylan (pour pas faire province, faut prononcer
Djèïlân) aura finalement réussi à nous écœurer et nous ôter toute envie d’aller faire du tourisme troglodyte en Cappadoce, tant le si joli décor finit par nous sortir par les yeux. Même la belle affiche nous horripile désormais dans la rue.
On ira donc plutôt à Ceylan (bon le Sri Lanka n’a rien à voir avec tout ça mais ça peut se prononcer Ceylan sans faire trop province).
Pour celles et ceux qui aiment le théâtre de Tchékov.
D’autres avis (dont beaucoup positifs) sur SensCritique.
 To make the world a safer place.
To make the world a safer place.

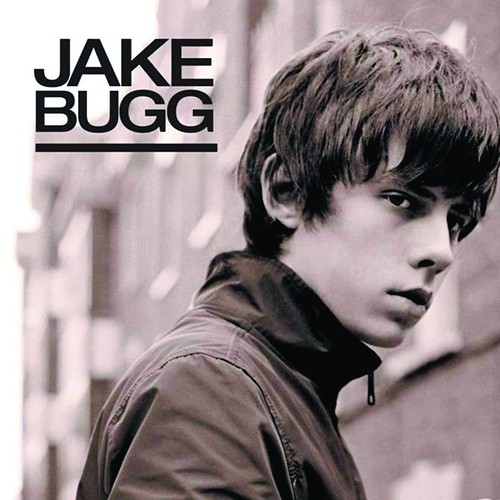


 Après de longues années vouées aux couleurs acryliques et rutilantes, la BD européenne, bousculée par l’irruption des
Après de longues années vouées aux couleurs acryliques et rutilantes, la BD européenne, bousculée par l’irruption des 

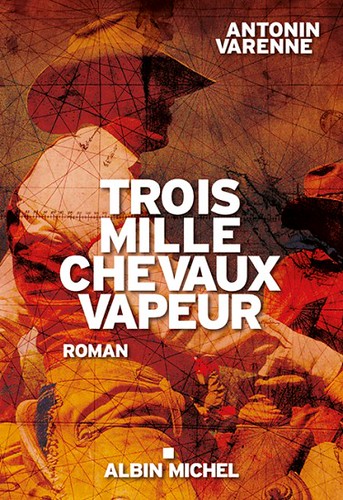
 Mais avant de partir pour le far-west, le sergent Bowman est d'abord passé par les Indes et la Birmanie : il était soldat pour la Compagnie des Indes Orientales, la britannique, la société privée qui reçut de la Reine Elisabeth les privilèges de frapper sa propre monnaie et recruter sa propre armée et dont les mercenaires terrorisèrent une grande partie de la planète … pour le bien de l'Empire.
Mais avant de partir pour le far-west, le sergent Bowman est d'abord passé par les Indes et la Birmanie : il était soldat pour la Compagnie des Indes Orientales, la britannique, la société privée qui reçut de la Reine Elisabeth les privilèges de frapper sa propre monnaie et recruter sa propre armée et dont les mercenaires terrorisèrent une grande partie de la planète … pour le bien de l'Empire.

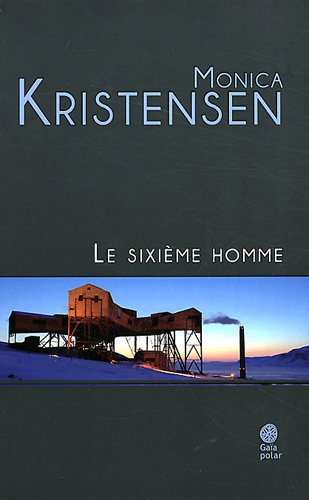
 Depuis les années vingt, ce territoire qui n'appartient à personne ou à tout le monde (un peu comme l'Antarctique) a été placé sous l'administration de la Norvège qui met un point d'honneur à le protéger scrupuleusement et à respecter les préceptes écologiques les plus stricts.
Depuis les années vingt, ce territoire qui n'appartient à personne ou à tout le monde (un peu comme l'Antarctique) a été placé sous l'administration de la Norvège qui met un point d'honneur à le protéger scrupuleusement et à respecter les préceptes écologiques les plus stricts.





