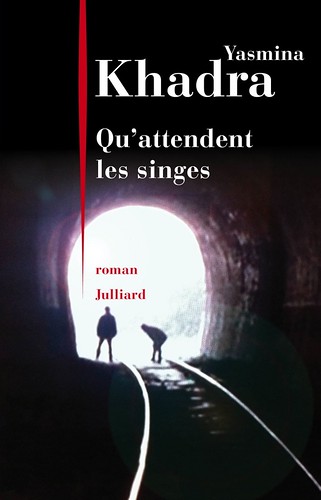
L'arabe du futur.
Pourtant sous le pinceau de Khadra, l'Algérie prend souvent des teintes désespérées et sombres, très loin de l'espoir que pourrait laisser poindre le vert du drapeau national ou du patronyme de l'auteur.
Qu'attendent les singes peine un peu à démarrer : Khadra place ses pions un par un et se laisse aller à quelques diatribes amères, quelques pamphlets un peu appuyés, emporté par son louable enthousiasme de prédicateur.
Alger est un marigot nauséabond et fangeux où claquent les mâchoires des vieux crocodiles cannibales, échoués après le reflux de la vieille Révolution.
C'est dans les tons amers et désabusés que l'auteur nous brosse le portrait d'une Algérie rongée par la prévarication, la violence (l'ombre de la 'décennie noire' obscurcit toujours le tableau) et la corruption.
[...] Un pays où l'on est fier de corrompre et d'être corrompu.Mais peu à peu l'intrigue policière se met en place et l'on enquêtera sur le meurtre sordide d'une toute jeune femme, aux côtés d'une commissaire couguar, amoureuse d'une jeune droguée, et d'un inspecteur impuissant.
[...] Un pays où les décideurs s'évertuent à construire une villa à leurs rejetons là où il est question de leur bâtir une nation.
[...] En Algérie, on n'a pas à faire, on fait des affaires.
[...] Comment expliquer que, malgré ses richesses inestimables, l'Algérie demeure pauvre en rêves et en ambitions et crapahute à la traîne des nations ?
— Tu ne vas peut-être pas me croire, mais j'ai de la peine pour notre patrie.
— On n'a que le pays qu'on mérite, Eddie. Il ne s'agit pas de fatalité.
— Je t'assure que j'ai peur pour les générations de demain.
— Elles s'en remettront.
[...] Le pouvoir est une effroyable sorcellerie, une possession démoniaque, une folie à l'état pur. Une fois contaminé, vous ne pouvez plus vous en défaire. C'est tellement enivrant.
Et si l'on veut filer la métaphore animale :
[...] — Je me disais bien que cette enquête banale cachait quelque chose, qu'il y avait anguille sous roche, mais là, je tombe des nues.
— Il va falloir vite te ressaisir, Eddie. L'anguille sous roche est un anaconda.
 Généreux, Khadra gratifiera son lecteur courageux d'un dernier chapitre en forme, sinon de happy end, tout au moins de vœu pieux, voire de promesse ou d'espoir, mais cela ressemble bien à une figure imposée et l'on a bien senti que le 'vrai' livre s'était refermé quelques pages tôt, au plus noir des ténèbres.
Généreux, Khadra gratifiera son lecteur courageux d'un dernier chapitre en forme, sinon de happy end, tout au moins de vœu pieux, voire de promesse ou d'espoir, mais cela ressemble bien à une figure imposée et l'on a bien senti que le 'vrai' livre s'était refermé quelques pages tôt, au plus noir des ténèbres.Brrr.. Jamais polar noir n'aura porté aussi bien son étiquette.
Paradoxalement cette gravure à l'eau-forte d'une nation dépravée et corrompue nous donne envie de mieux connaître ce pays à la fois si proche et si différent, caché derrière les épais brouillards politico-médiatiques qui couvrent la Méditerranée depuis un demi-siècle. Entre les vestiges de la colonisation et le prisme déformant du regard de Khadra lui-même, il est difficile de ne pas lire entre les lignes une Algérie qui partage une même culture avec notre France et un Alger qui ressemblerait bien à Paris.
Évidemment on se doute bien que al-Jazā'ir n'est pas la seule nation à porter tout le malheur du monde et que le portrait au noir, même un peu forcé ici, était bien celui de notre temps et de notre planète.
De quoi laisser trottiner longtemps dans notre tête la petite phrase de Khadra ...
[...] — Qu'attendent les singes pour devenir des hommes ?
— Pardon ?
— Je ne me rappelle pas où j'ai lu ça. Qu'attendent les singes pour devenir des hommes. Cette phrase tourne en boucle dans ma tête depuis des semaines.
Pour celles et ceux qui aiment les portraits-vérité.
D’autres avis sur Babelio.



 Depuis la
Depuis la 

 Le bûcher des vanités.
Le bûcher des vanités. Surfant sur le succès de la mémorable
Surfant sur le succès de la mémorable 

